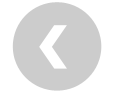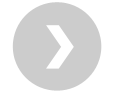Boris Thiolay. Le destin de Dominique "Domingo" Amestoy aurait pu inspirer Hollywood. À sa mort, en 1892, il était richissime, propriétaire de plusieurs ranchs et l’un des plus gros producteurs de laine de Californie, avec 30 000 moutons mérinos. En 1871, quelques années après son arrivée dans l’ouest des États-Unis, il avait acheté pour 500 000 dollars d’actions de la nouvelle Farmers and Merchants Bank de Los Angeles. Aujourd’hui encore, et depuis 1916, l’avenue Amestoy traverse la vallée de San Fernando sur une quinzaine de kilomètres, au nord-ouest de la Cité des Anges et deux autres axes routiers portent le nom d’une de ses filles, Louise, et d’une de ses petites-filles, Noeline.
Un exode basque dû aux droits de succession
Domingo Amestoy était né en France en 1822 dans une famille modeste de Saint-Pierre d’Irube, près de Bayonne. Sa réussite fut exceptionnelle et sa trajectoire, le reflet d’une histoire étonnante : celle des dizaines de milliers de Basques qui émigrèrent "aux Amériques", à partir des années 1830. Un phénomène massif, qui s’est poursuivi jusqu’aux années 1960. "Environ 200 000 Basques de France et d’Espagne ont émigré entre 1830 et 1930, d’abord essentiellement en Uruguay et en Argentine, puis vers l’ouest des États-Unis, explique l’historienne Argitxu Camus Etchecopar, autrice d’une thèse, à l’université du Nevada, sur les organisations basques aux États-Unis. C’était énorme : en 1900, les sept provinces basques historiques ne comptaient qu’un million d’habitants !"
Pourquoi un tel exode ? L’une des principales raisons était liée au droit d’aînesse intégral pratiqué lors des successions au Pays basque : une seule personne, fille ou garçon, héritait de la maison, de la ferme et de ses dépendances. Il s’agissait en effet d’éviter la division du patrimoine au sein de familles nombreuses vivant sur de petites exploitations. Or ce risque fut accru en France en raison de l’égalité de traitement des héritiers prévue par le Code civil à partir de 1804. De plus, l’absence de débouchés économiques, les troubles politiques – la guerre d’indépendance espagnole (1808-1814), les guerres carlistes de succession –, ainsi que la volonté d’échapper à la conscription, poussèrent une première vague de jeunes gens à quitter la région, notamment pour l’Uruguay et l’Argentine, des pays "neufs" qui cherchaient à attirer des immigrants.
La ruée vers l’or suscita un appel d’air mondial
À partir de 1849, la découverte de gisements aurifères en Californie, suivie d’une ruée vers l’or, suscita un appel d’air mondial : dans les confins franco-espagnols, des fratries entières plièrent bagage, des vallées se vidèrent de leurs habitants ; et des Basques déjà établis en Amérique latine se mirent en route pour le nord… Les nouveaux arrivants s’établirent tout d’abord autour de San Francisco et de Los Angeles. Les hommes trouvèrent naturellement un emploi de berger. "Rapidement, certains sont devenus éleveurs, ont acheté des terres et ouvert un ranch, en se regroupant par affinités identitaires ou d’origines, notamment basco-béarnaises, explique Annick Foucrier, historienne spécialiste des relations franco-américaines et des migrations internationales. Ils ont fait venir leur fiancée et de la main-d’oeuvre depuis leur village ou leur région d’origine. Les femmes, qui ont bientôt représenté 30 % des immigrants, travaillaient comme nounous, employées dans les boutiques, cuisinières ou femmes de chambre dans les hôtels basques, généralement tenus par un couple…"
Le premier établissement du genre, sans surprise nommé Hotel Vasco, aurait été ouvert par un certain Juan Miguel Aguirre en 1866, sur Powell Street, en plein centre de San Francisco. L’homme avait commencé par vendre de l’eau en tonneau aux chercheurs d’or… Les hôtels-restaurants basques constituaient les points de ralliement de la communauté, où s’organisaient banquets, bals et jeux traditionnels, comme la pelote. C’est là également que venaient se reposer les bergers, au retour de longs mois de transhumance avec leurs milliers de moutons, dans le désert du Mojave, entre la Californie et le Nevada. "Tous les Basques n’étaient pas bergers, mais tous les bergers étaient basques !, résume l’historienne Argitxu Camus Etchecopar. Leurs conditions de vie étaient très dures et les gardiens de troupeaux itinérants, qui ne parlaient pas l’anglais, étaient considérés comme des vagabonds par les grands propriétaires terriens."
À partir des années 1860, des agents d’émigration travaillant pour des compagnies maritimes s’installèrent au Pays basque pour recruter des candidats au départ, souvent en leur avançant le prix du voyage. Ou plutôt, de l’odyssée : d’abord, la traversée de l’Atlantique, depuis Le Havre jusqu’à Ellis Island, dans la baie de New York, puis celle du continent américain d’est en ouest, grâce au chemin de fer. Les nouveaux venus, notamment ceux originaires des provinces espagnoles, s’établissaient plutôt dans l’Idaho et le Nevada. Les Basques français continuaient, eux, de privilégier la Californie, trouvant à s’employer, s’ils ne devenaient pas bergers, comme jardiniers à San Francisco et comme éleveurs de vaches laitières autour de Bakersfield et de Chino.
Des missionnaires ont permis le maintien des liens communautaires
Dans l’Ouest américain, les Basques, catholiques très pratiquants, se retrouvaient autour de messes servies par des prêtres missionnaires dépêchés, entre autres, par le diocèse de Bayonne (lequel a maintenu cet usage jusqu’en 2008). À partir de 1876, une cinquantaine de moines bénédictins et de religieuses s’établirent ainsi dans l’abbaye du Sacré-Coeur, en territoire indien, près de l’actuelle ville de Konawa (Oklahoma).
Des aumôniers itinérants entamèrent des missions à la rencontre des fidèles basques du Far West. En 1905, ils fondèrent une chapelle à Montebello, petite ville aujourd’hui englobée dans la périphérie est de Los Angeles. Un prêtre, Charles Espelette, né à Aldudes (Pyrénées-Atlantiques) en 1883, s’y installa en 1933. "Ces missionnaires ont joué un rôle important dans le maintien des liens communautaires, reprend l’historienne Annick Foucrier. À la religion s’ajoutaient la pratique de la langue et les traditions culturelles. Le père Espelette, par exemple, avait fondé un club [Euskualdun, "le Basque"] en Californie, où il enseignait les danses traditionnelles aux jeunes." À partir de 1936, la guerre civile espagnole, puis la répression de la culture basque par Franco, provoqua une nouvelle série de départs. Et côté français, les Basques venus garder les troupeaux continuèrent de bénéficier, jusque dans les années 1960, de dérogations sur les quotas d’immigration aux États-Unis.
Au sein de la diaspora des Amerikanuak ("Basques américains"), la figure du berger, travailleur, loyal et dur au mal, est restée le symbole d’une intégration obtenue à force de sacrifices. Et les Basques sont très chatouilleux sur cette partie de leur histoire. En 1989, un concours d’artistes avait été lancé pour ériger un monument en hommage à ces bergers, mais le jour de son inauguration à Reno (Nevada), l’oeuvre abstraite retenue, de six mètres de haut, signée par le sculpteur avant-gardiste Nestor Basterretxea (1924-2014), déplut tant à la communauté locale qu’un certain John Ascuaga décida d’acheter l’autre oeuvre finaliste – une statue figurative d’un berger avec son béret, son bâton de marche, son chien et portant un agneau sous le bras – pour la placer devant son hôtel-casino. Depuis la vente de l’établissement, en 2020, la statue est installée sur le campus de l’université du Nevada, à côté du Centre d’études basques.
Près de 60 000 Américains revendiquent une ascendance basque
Aujourd’hui, environ 60 000 Américains revendiquent une ascendance basque. La langue n’est plus pratiquée, cependant certaines familles l’ont conservée sur plusieurs générations, et les traditions restent ancrées. Une quarantaine d’associations culturelles et sportives sont recensées à New York et dans l’Ouest américain : des clubs de pelote, et des maisons basques (Euskal Etxeak), centres où sont organisés fêtes, expositions ou cours de langue… À Boise (235 000 habitants), capitale de l’Idaho, 15 000 personnes se disent d’origine basque. En plein centre-ville, le Basque Block a un air de village avec un restaurant, un bar, une épicerie, un marché hebdomadaire, un fronton couvert (le mur du jeu de pelote), un centre communautaire aménagé dans un ancien hôtel et un musée. Deux larges croix basques sont peintes sur West Grove, la rue qui longe ces bâtiments pavoisés de rouge, vert et blanc, les couleurs de l’ikurrina. "Depuis quelques années, on voit de jeunes Américains venir en séjour d’immersion linguistique durant plusieurs mois au Pays basque pour renouer avec leurs racines", relève Argitxu Camus Etchecopar.
L’importance de cette diaspora fut bien résumée par cette formule de l’écrivain Pierre Lhande, en 1910 : "Pour être un authentique Basque, trois conditions sont nécessaires : avoir un nom sonnant basque, parler la langue d’Aitor [la figure tutélaire des Basques], et… avoir un oncle en Amérique."
(Article paru dans le magazine GEO Histoire n°102, "La saga des Français qui ont fait l'Amérique", de juillet-août 2025)
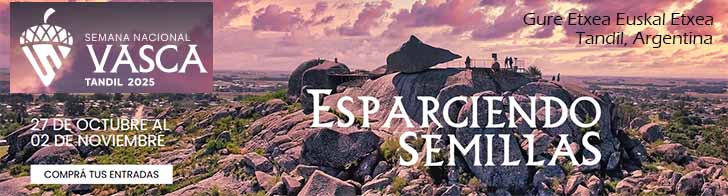


 Enviar a un amigo
Enviar a un amigo Añadir comentario
Añadir comentario